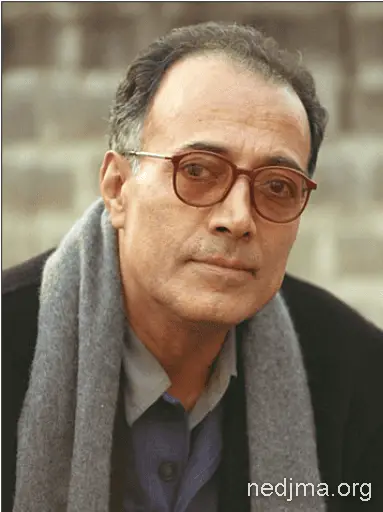
Panorama de la production cinématographique iranienne des origines à nos jours.
Contrairement à la plupart des pays, l’Iran n’aborde pas le cinéma comme un divertissement populaire mais comme un plaisir privé. Découvrant le cinéma à l’Exposition universelle de 1900, Muzzafar al-Din Chah achète une caméra et fait filmer des scènes de la vie des princes par son photographe Mirza Ibrahim Khan. Le cinéma devient alors un divertissement de cour très prisé.
À Téhéran, deux salles proposent en 1907 des films Edison puis Pathé, mais sont détruites à la suite de troubles politiques. De nouvelles salles ouvrent à partir de 1912, remplaçant les anciennes séances d’« ombres magiques ». Une salle est accordée à Téhéran aux femmes en 1925, mais la mixité ne sera admise qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1926, on filme le Couronnement de Riza Chah.
En 1930, un Arménien, Avanes Ohanian, formé en Union soviétique, réalise le premier film de fiction, Abi et Rabi (Abi va Ravi), puis Hadji Agha, acteur de cinéma (Hâdji Agha, actor-e cinema), et fonde une école de cinéma à Téhéran. Le poète Abdolhosein Sepanta inspire ensuite à Ardeshir Marwan Irani la Fille de Lorestan (Dokhtar Lor, 1933), premier film parlant persan, tourné à Bombay, qui remporte un très grand succès. Sepanta réalise ensuite, toujours en Inde, les Yeux noirs (Tchechmane Chah, 1934) et Layli et Majnun (1935), version persane de Roméo et Juliette, puis la biographie d’un poète lyrique du XIe siècle, Ferdowsi. Mais de retour en Iran, il se heurte à la méfiance du pouvoir et à l’opposition des compagnies américaines.
En 1947, la première firme de production, Pars Film, est fondée par Ismâil Kuchân et demeure en situation de quasi-monopole jusque dans les années quatre-vingt. Le doublage de films français en persan avait commencé durant la Seconde Guerre mondiale et la version doublée de Premier Rendez-vous de Henri Decoin (1941) a un tel succès qu’elle permet de financer la Tempête de l’existence (Tufâne Zengedi, 1947) de Muhammad Ali Daryâbegi.
Avec une production annuelle d’une vingtaine de films, le cinéma iranien est alors une industrie de divertissement centrée sur les mélodrames imités du cinéma hindi, comme le Truand chevaleresque (Lât-e Javanmard, 1957) de Majid Mohseni, les comédies comme Une soirée en enfer (Shab neshini dar jahannam, 1957) de Musheq Susuri, et les films d’action inspirés du cinéma occidental. Lorsqu’en 1958 Farrokh Gaffary situe une histoire de truands dans des décors naturels de quartiers populaires, son film le Sud de la ville (Jonube Charhr), jugé trop réaliste, est saisi. Son réalisateur se limitera désormais à la comédie (Qui est la mariée ?, Arus Kodumek ?, 1959) et à des contes de qualité, mais prudents, comme la Nuit du bossu (Chan-e Quzi, 1963). En 1965, Ibrahim Golestan réalise la Brique et le miroir (Khest va Ayeneh), et Fereydun Rahnama Siavash à Persepolis (Siavash dar takht-e Jamshid), films exigeants qui ne rencontrent ni succès public ni attention de la critique iranienne.
Dès 1969 apparaît le premier signe de renouveau dans le cinéma iranien, avec la Vache (Gav) de Dariush Mehrjui, entre documentaire et fable cruelle sur la misère paysanne mais le film est bloqué deux ans par la censure. En 1974, l’auteur récidive avec le Cycle (Dayereh-ye mina), allégorie du système politique à partir d’un trafic de sang autour d’un hôpital. Quoique produit pour la télévision par le beau-frère du chah, le film est interdit trois ans.
Admirateur d’Anton Tchekhov et de Robert Bresson, Soharab Chahid Saless, très formaliste, débute avec Un simple événement (Yek étéfdagh é sadeh, 1973) puis réalise Nature morte (Tabiat é bijan, 1974), sur des personnages qu’un événement soudain rend étrangers au monde. Très calligraphié également est le film d’Arbi Ovanesian, la Source (Cheshmeh, 1970), tandis que Parviz Kimiani s’inspire d’Antonioni et de Godard dans les Mongols (Moghola, 1973). L’Averse (Ragbar, 1972) et l’Étranger et le brouillard (Gharibeh, 1974) de Bahram Beyzai sont des « films d’auteur » intimistes.
En 1969 est créée une cellule cinématographique à l’intérieur de l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, dit « Kanun », cellule dirigée par Abbas Kiarostami qui tourne dans ce cadre son premier court métrage, le Pain et la rue (Nan va koutcheh, 1970) puis son premier long métrage, le Passager (Mossafer, 1974), histoire d’un enfant prêt à tout pour assister à un match de football à Téhéran. L’approche de Kiarostami se situe entre la métaphore sociale et le réalisme quotidien.
En 1973, Amir Naderi réalise également dans le cadre du « Kanun » l’Harmonica (Saz-e dahani), fable cruelle sur l’enfance. De nombreux cinéastes débutent ou passent à un moment ou un autre par le « Kanun », comme Chahid Sales, Mehrjui, Beyzaï, Ebrahim Furuzesh, et Jafar Panahi.
Non sans démêlés avec la censure et en marge de la production purement commerciale, une école iranienne de cinéma d’auteur, encouragée aussi bien par le ministère de la Culture et des Arts que par la télévision officielle, se met alors en place.
Le pouvoir de Muhammad Riza Chah encourage également le Festival de Téhéran et les tournages sur le territoire iranien comme les coproductions avec l’étranger telles the Other Side of the Wind (1970-1972) et Vérités et mensonges (For Fake, 1975) d’Orson Welles ou la Chair de l’orchidée (1975) de Patrice Chéreau. Créé en 1976, le Fonds de développement du cinéma iranien participe également à la production du Désert des Tartares (il Deserto dei tartari, 1976) de Valerio Zurlini.
Avec le triomphe de la révolution islamique, la production, déjà très réduite en raison des actions de la police secrète et des islamistes intégristes contre les salles de cinéma, s’effondre. En 1983, la Fondation Farabi est créée pour contrôler tous les aspects du cinéma. Le mot d’ordre est la lutte contre la culture occidentale et pour le respect des lois religieuses. Des films jugés corrompus comme Notre école (Madreseh-ye Keh Miraftim, 1980-1985) de Dariush Mehrjui, ou Recherche (Josteju, 1980-1981) sont interdits. De nombreux cinéastes iraniens s’expatrient alors. Après l’interdiction du Coureur (Barandeh, 1985) et de l’Eau, le Vent, la Terre (Ab, Bad, Khk, 1985), Amir Naderi émigre aux États-Unis. Chahid Sales travaille à partir de 1975 en Allemagne. Iradj Azimi, lui, a quitté son pays dès 1960 et a développé en France une œuvre subtile, d’une grande beauté plastique, attentive à la matière, aux sons, aux vibrations musicales : les Jours gris (1974), Utopia (1978) et les Îles (1981). En 1988, il se lance dans une œuvre très ambitieuse, le Radeau de la méduse, qui se heurte à de nombreux incidents de tournage. Ce film naufragé connaît une sortie discrète en 1998, et ne rencontre guère de succès.
Après 1988, en Iran, l’étau se desserre. Dans le cadre du « Kanun », Abbas Kiarostami, désormais considéré par ses pairs du monde entier comme un réalisateur de tout premier plan, poursuit une œuvre très originale qui prend tour à tour pour thèmes l’enfant en quête de solidarité, refusant les règles imposées, dans Où est la maison de mon ami ? (Kahneh-ye dust kojast ?, 1987), un tremblement de terre symbolisant la déchirure de l’Iran dans Et la vie continue (Va Zendegi edameh darad, 1992) et les rêves et mensonges du cinéma dans Close Up (Namay-e nazdik, 1991). En 1997, il livre une œuvre particulièrement noire, le Goût de la cerise (Tam-e guilass).
Le cinéma iranien d’aujourd’hui ne se réduit pourtant pas à un seul nom. Dariush Mehrjui est revenu à la critique sociale avec les Locataires (Ejerah Neshinha, 1987) et a adapté en 1993 la Maison de poupée, d’Ibsen, dans Sara. Barham Beyzaï est connu à l’étranger par son Bashu, le petit étranger (Bashu, gharibe-ye kutchek, 1985), un temps retenu par la censure iranienne. Importante est également l’œuvre de Mohsen Makhmalbaf, militant islamiste et prisonnier politique sous le régime du Chah. Le Camelot (Dastforouh, 1987), le Cycliste (Bicycleran, 1989) et la Noce des bénis (Arousi-ye Khouban, 1989) établissent sa réputation de cinéaste à la fois officiel et dérangeant. Le Temps de l’amour (Nobat-e-Ashegi, 1990) est même interdit par la censure. Ses films récents, Salam Cinema (1995) et Nun va Goldoon (Un instant d’innocence, 1996) ont le cinéma lui-même pour sujet. Farhad Mahranfar, autre réalisateur, s’interroge également sur le septième art dans Avions de papier (1998).
Paradoxalement, en raison des interdits religieux concernant le regard de l’homme sur le corps féminin, plusieurs femmes exercent le métier de réalisatrice en Iran, comme Rakhstan Bani Etenad, Tahminek Milani et Pouran Darakhsandeh. La dernière en date est la propre fille de Makhmalbaf, Samira, qui réalise à dix-huit ans un premier film très personnel, la Pomme (Sib, 1998). Il serait néanmoins hâtif d’en conclure que le cinéma iranien a trouvé sa pleine liberté. En 1994, des cinéastes ont publié une lettre ouverte anonyme protestant contre la dictature de la Fondation Farabi et l’interdiction de Banou (Banoo, 1992) de Mehrjui, de la Mort de Yazdagerd (Margué Yazdagerd, 1980) et des Voyageurs (Mosaferan, 1992) de Beyzaï.
Microsoft ® Encarta